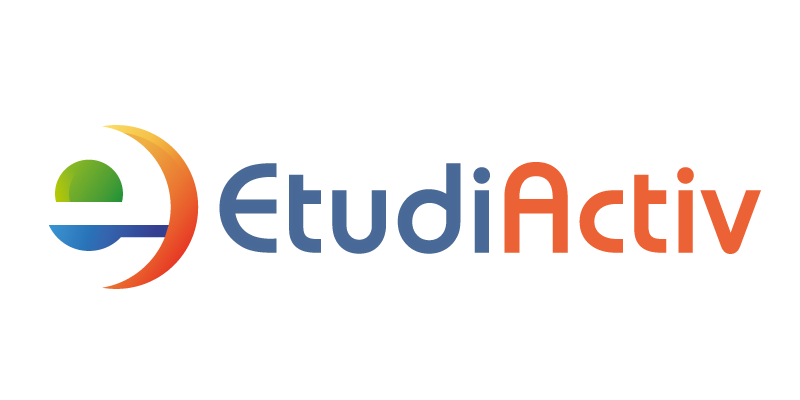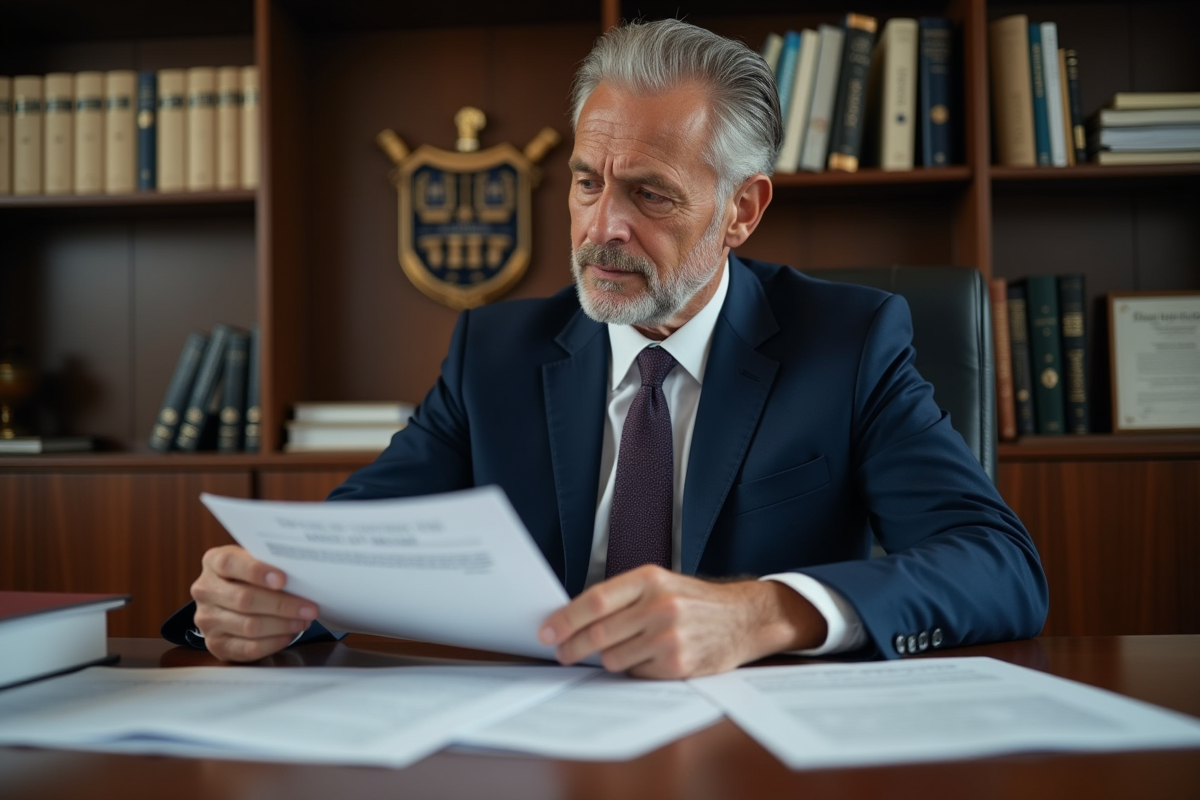Jusqu’en 2002, le diplôme universitaire connu aujourd’hui sous le nom de Master portait une toute autre appellation en France : la maîtrise. Cette modification de terminologie s’inscrit dans une vaste refonte du système européen de l’enseignement supérieur, impulsée par le processus de Bologne.
L’ancienne nomenclature, mêlant licence, maîtrise et DEA ou DESS, a laissé place à un schéma en trois cycles, aligné sur les standards internationaux. L’histoire et l’évolution de ce diplôme témoignent d’une adaptation permanente aux enjeux académiques et professionnels.
Le master en histoire : d’où vient-il et comment a-t-il évolué ?
Dans le paysage des sciences humaines et sociales, la formation universitaire en histoire n’a pas toujours eu le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Pendant des décennies, le cursus s’articulait en plusieurs étapes bien distinctes. On passait d’abord par la licence, puis la maîtrise, avant d’atteindre le DEA ou le DESS. Ce découpage, profondément ancré, s’est vu bouleversé au tournant des années 2000 avec l’arrivée du système LMD. Un coup de balai qui n’a rien laissé au hasard, mais a voulu rapprocher les diplômes français de ceux du reste de l’Europe. Désormais, chaque année d’études s’accompagne de crédits ECTS, ce qui simplifie la reconnaissance des diplômes partout sur le continent.
Du côté du master d’histoire, le parcours se dessine aujourd’hui sur deux ans après la licence, soit cinq années d’études après le baccalauréat. Ce diplôme attire les étudiants venus des filières arts, lettres, langues, mais aussi plus largement des sciences humaines. Au fil du temps, les programmes ont évolué pour coller aux réalités de la recherche et des métiers qui gravitent autour de l’analyse des sources, de la valorisation du patrimoine ou de l’enseignement.
Les différentes voies proposées en master d’histoire mettent en avant l’acquisition de méthodes solides : apprendre à lire et interroger les sources, bâtir un mémoire de recherche rigoureux, manier les langues vivantes quand le sujet l’exige. Les étudiants alternent séminaires, travaux dirigés et, parfois, périodes de stage pour se préparer à la vie professionnelle. Cette transformation marque une volonté d’ouverture sur l’Europe et le monde, mais aussi d’offrir aux étudiants des repères clairs pour s’orienter.
Quels étaient les anciens noms et diplômes avant le master ?
Avant que le master ne fasse son apparition, le parcours universitaire français se décomposait en plusieurs étapes précises. Après le baccalauréat, il fallait décrocher la licence (bac+3), puis viser la maîtrise (bac+4), étape charnière marquée par la rédaction d’un mémoire. Ceux qui souhaitaient aller plus loin avaient alors deux options : le DEA ou le DESS, tous deux correspondant à un niveau bac+5.
Pour mieux saisir la différence entre ces deux diplômes, voici un aperçu de leurs spécificités :
- DEA : consacré à la recherche, il ouvrait la porte au doctorat en histoire ou en sciences humaines.
- DESS : pensé pour ceux qui visaient une entrée rapide dans la vie active, souvent dans la gestion du patrimoine ou la médiation culturelle.
Au début des années 2000, la réforme LMD a rassemblé la maîtrise et le DEA/DESS au sein d’un seul et même cycle : le master. Ce changement a rapproché la France du modèle européen, rendant les cursus plus lisibles et les passages d’un pays à l’autre plus simples. Les dénominations « maîtrise », « DEA » et « DESS » ont disparu au profit d’un master en deux ans, clairement identifié, jalonné de crédits ECTS. La structure s’est simplifiée, mais les possibilités de parcours, en histoire notamment, sont restées variées.
Panorama des parcours et spécialisations possibles en master d’histoire
Les formations de master d’histoire se déclinent en une large palette de parcours, à l’image de la diversité du domaine. Dès la première année, les étudiants naviguent entre différentes périodes, histoire médiévale, histoire moderne, époque contemporaine, et croisent des thématiques allant de l’histoire politique à la sociologie, en passant par l’histoire des idées ou la science politique.
Pour montrer la variété des options offertes, les universités détaillent leurs spécialisations :
- Des cursus généralistes qui couvrent de larges périodes ou aires culturelles
- Des spécialisations comme le master histoire de l’art et archéologie, pour explorer les objets, images et vestiges du passé
- Des parcours axés sur la valorisation du patrimoine ou la gestion des archives, menant aux métiers des musées, des collectivités ou des services culturels
L’ouverture internationale prend aussi de l’ampleur. Certains cursus intègrent l’anglais ou l’allemand, parfois proposent des échanges à l’étranger. Les doubles parcours, mêlant lettres, langues et histoire, ouvrent sur des horizons extra-européens. La deuxième année est structurée par la rédaction d’un mémoire de recherche, accompagnée de travaux dirigés, séminaires, stages et valorisation des sources historiques. Cette combinaison forge l’autonomie et l’esprit critique, qualités recherchées au terme du master.
Débouchés professionnels : explorer les perspectives après un master en histoire
Le master histoire ouvre la porte à un large éventail de secteurs d’activité. L’enseignement reste une voie privilégiée : beaucoup se préparent aux concours de la fonction publique comme le CAPES ou l’agrégation, tandis que d’autres choisissent le professorat des écoles ou l’enseignement supérieur après un doctorat.
Mais il n’y a pas que l’éducation nationale. Les métiers du patrimoine recrutent : conservateur de musée, chargé d’inventaire, médiateur culturel. Les collectivités, les bibliothèques, les institutions culturelles apprécient les spécialistes capables de contextualiser et de transmettre les sources historiques.
Le secteur privé n’est pas en reste. Cabinets de conseil, maisons d’édition, médias, agences de communication cherchent des profils capables d’analyser avec rigueur, de rédiger des contenus précis, de gérer des projets documentaires ou éditoriaux. Certains diplômés se tournent vers la gestion de projets européens, la veille stratégique ou la médiation scientifique.
Voici un aperçu des débouchés courants après un master d’histoire :
- Enseignement secondaire et supérieur
- Métiers du patrimoine et de la culture
- Rédaction, édition, journalisme
- Gestion de projets et communication
La rédaction d’un mémoire de recherche et l’expérience acquise lors d’un stage renforcent l’autonomie et la capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires. Les diplômés du master sciences humaines disposent ainsi des atouts nécessaires pour s’orienter vers des carrières variées, que ce soit sur le territoire national ou à travers l’Europe.
La maîtrise a disparu, le master s’impose : un diplôme qui porte en lui la mémoire des anciens cursus et la promesse de nouvelles perspectives, pour tous ceux qui veulent écrire l’histoire autrement.